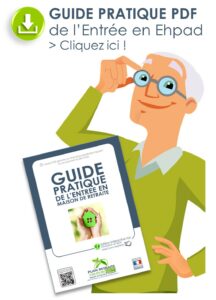>>> Maladie Dépendances / Maladie d'ALZHEIMER
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par la perte progressive de la mémoire, des fonctions cognitives et s’accompagne fréquemment de troubles comportementaux et psychologiques.
Elle est due à la présence de plaques séniles et de dégénérescences au niveau du cortex cérébral. Même si l’origine de cette dégénérescence est encore mal connue, celle-ci constitue bien la cause identifiée de la maladie. Cette dégénérescence progressive provoque l’apparition de nombreux symptômes.
Les troubles liés à la maladie évoluent avec le temps et s’aggravent progressivement.
Au début de la maladie, la mémoire, les capacités de jugement et de raisonnement se détériorent. La mémoire immédiate et le fonctionnement mental sont d’abord touchés, puis apparaissent une altération du langage, une difficulté à effectuer des gestes élaborés, des troubles de l’orientation temporelle et spatiale, une impossibilité à reconnaître des personnes de son entourage (conjoint, famille, ami…).
Par ailleurs, l’humeur, le comportement, ainsi que la faculté à se concentrer se dégradent.
L’évolution de la maladie diffère d’un patient à l’autre, mais finit par avoir un impact très important sur l’état général. Les troubles alimentaires et les problèmes de déglutition engendrent un amaigrissement conséquent. Progressivement, le patient devient totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne ( perte de la capacité de s’habiller, de se laver, d’aller aux toilettes...).
Actuellement il n’existe pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Les médicaments disponibles aujourd’hui ont uniquement pour objectif de diminuer ses effets. Ils permettent notamment de lutter contre l’agitation, la dépression, les hallucinations ou encore l’insomnie.
 Aller plus loin...
Aller plus loin...
 La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
GUIDE d'aide à l'orientation des malades et des familles - Ile de France - Ars Ile de France
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
GUIDE d'aide à l'orientation des malades et des familles - Ile de France - Ars Ile de France
 La maladie d’Alzheimer - solidaritessante.gouv.fr
La maladie d’Alzheimer - solidaritessante.gouv.fr
 France Alzheimer et maladies apparentées - francealzheimer.org
Fondation Alzheimer - fondation-alzheimer.org
Fondation Vaincre Alzheimer - vaincrealzheimer.org
France Alzheimer et maladies apparentées - francealzheimer.org
Fondation Alzheimer - fondation-alzheimer.org
Fondation Vaincre Alzheimer - vaincrealzheimer.org
/
Les consultations mémoire
La maladie d’Alzheimer a un caractère évolutif. Son diagnostic précoce va permettre une meilleure prise en charge afin d’améliorer les conditions de vie du patient et de son entourage.
Les consultations mémoire sont ouvertes à toute personne présentant des troubles de la mémoire et/ou des troubles cognitifs ( le raisonnement, le jugement, la compréhension…).
Les troubles sont évalués grâce à un bilan complet : bilan clinique, évaluation psychologique, examens biologiques et examens d’imagerie médicale.
A l’issue de ce bilan, ces consultations mémoires permettent :
- soit de rassurer les personnes exprimant une plainte mnésique mais n’ayant pas de syndrome démentiel,
- soit de diagnostiquer avec fiabilité un syndrome démentiel et le type de maladie.
Ces consultations participent au suivi des personnes malades et de leurs aidants en partenariat avec le médecin traitant. Elles sont réalisées soit au sein d’un hôpital disposant d’une « consultation mémoire » ou auprès de neurologues libéraux ( voir le site de l’association des neurologues libéraux de langue française – anllf.org ).
Les consultations mémoires constituent un premier niveau du dispositif de diagnostic et de prise en charge de la maladie d’Alzheimer. A un deuxième niveau, les Centres Mémoire de Ressources et de Recherche (CM2R) reçoivent les patients dont les troubles nécessitent une expertise plus approfondie. Ils ont un rôle d’expertise en cas de diagnostic complexe.
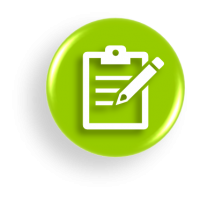 Trouver un acteur près de chez vous :
Centres et consultations Mémoire d'Ile de France - Source Fédération des centres mémoires
Trouver un acteur près de chez vous :
Centres et consultations Mémoire d'Ile de France - Source Fédération des centres mémoires
Unité Protégée, Unité de Soins Adaptés, Unité Alzheimer...
Présentes au sein de certains Ehpad, ces petites unités de vie sont destinées aux personnes âgées les plus désorientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Ces unités disposent d’un équipement adapté à la surveillance des résidents souffrant de troubles majeurs du comportement. L’équipe pluridisciplinaire, les locaux et la vie au sein de l’unité sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Le personnel d’encadrement est diplômé et formé à la prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs et/ou psycho-comportementaux.
A noter qu’il existe des Ehpad entièrement dédiés à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et aux troubles apparentés.
PASA et UHR
Pour les patients souffrant de troubles du comportement et en fonction du niveau de ces troubles, il existe également deux autres types d’unités spécifiques au sein de certains Ehpad. Ces Ehpad peuvent ainsi proposer des prises en charge différenciées et évolutives en fonction de la gravité de l’état des malades :
- des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés ou PASA proposant, pendant la journée, aux résidents ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales et thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement rassurant et permettant la déambulation.
- des Unités d’Hébergement Renforcées UHR pour les résidents ayant des troubles sévères du comportement, sous forme de petites unités accueillant nuit et jour, qui soient à la fois lieu d’hébergement et lieu d’activités.
Ces unités sont animées par des professionnels spécifiquement formés : des assistants de soins en gérontologie, nouvelle fonction qui va être créée, un psychomotricien ou un ergothérapeute.
L’objectif principal est de permettre une vie de qualité pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée, en termes de bien-être et d’état de santé, jusqu’en fin de vie.
En effet, les personnes pourront encore nouer des liens affectifs et sociaux susceptibles de leur procurer du réconfort et du plaisir.
Dans cette perspective, l’accompagnement en établissement médico-social a pour but :
- de préserver, maintenir et/ou restaurer l’autonomie de la personne, dans les choix et actes de la vie quotidienne comme dans les décisions importantes à prendre ;
- de mettre en place des mesures préventives et thérapeutiques des troubles psychologiques et comportementaux ;
- d’assurer à chaque personne un accès à des soins de qualité, sans discrimination liée à l’âge ou aux troubles cognitifs ;
- de soutenir les proches en fonction de leurs attentes, les aider à maintenir du lien avec le malade et de leur proposer une participation active au projet personnalisé.
Source solidarites-sante.gouv.fr
Information sur les troubles psychologiques et comportementaux
Les troubles psychologiques et comportementaux sont une complication fréquente de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et un facteur important contribuant à la perte d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne et accentuant le risque de dépendance.
Ils sont classés en troubles productifs et non productifs (cf. ci-dessous).
Les troubles productifs sont considérés comme les plus difficiles à gérer par les proches et les équipes car envahissants et difficilement supportables pour les autres (proches, aidants, autres personnes accueillies) :
agitation / agressivité / irritabilité / désinhibition / comportements d’opposition / déambulation / cris / comportements moteurs aberrants / troubles psychotiques (hallucinations, délires) / troubles du sommeil.
A l’inverse, les troubles non productifs sont trop souvent négligés car peu dérangeants :
dépression / apathie / repli sur soi. Ils doivent pourtant faire l’objet de la même attention que les troubles dits productifs.
Les conséquences des troubles psychologiques et comportementaux sur la personne mais aussi sur les aidants (détresse, épuisement, risque de maltraitance, etc.) et sur les équipes font de leur prévention et de leur prise en charge un enjeu majeur.
Dans tous les cas, les troubles psychologiques et comportementaux, qu’ils soient dits « productifs» ou «non productifs », doivent faire l’objet de mesures spécifiques à la fois préventives et thérapeutiques.
La prévention et la prise en charge des troubles psychologiques et comportementaux s’articulent autour de trois axes : des mesures préventives environnementales ; une évaluation et des mesures thérapeutiques si des troubles apparaissent ; des mesures visant les aidants.
 Les changements psycho-comportementaux
Livret d’informations destiné aux aidants - Source Hôpitaux de St Maurice
Les changements psycho-comportementaux
Livret d’informations destiné aux aidants - Source Hôpitaux de St Maurice
TESTS et Troubles Cognitifs
- Test MMSE (Mini-Mental State Examination) ou Test de Folstein
“Le test MMSE permet au clinicien une évaluation rapide des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d’une personne (orientation temporelle et spatiale, mémoire immédiate et récente, calcul mental, dénomination d’objets usuels, répétition de mots, compréhension orale et d’ordres écrits, structuration et intégration de données visuospatiales).
Les épreuves restent cependant trop faciles pour des patients de bon niveau intellectuel et, dans les démences débutantes, de faux résultats négatifs ne sont pas rares. Enfin, le résultat global du MMSE ne préjuge jamais de la nature ni de l’étiologie de l’éventuelle altération constatée (troubles organiques cérébraux ou troubles fonctionnels d’origine dépressive, p. ex.). Il est notamment employé dans le cadre d’un dépistage de la démence de type Alzheimer”. Source Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine
>>> Test MMSE – has-sante.fr
- Test MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
Le test MoCA est une évaluation courte de 30 questions conçue pour aider le personnel soignant à détecter hâtivement les troubles cognitifs, de manière à obtenir un diagnostic et des soins rapides pour le patient. Le MoCA Test est la méthode la plus précise qui existe pour détecter la maladie d’Alzheimer, pour mesurer les fonctions exécutives et pour évaluer plusieurs domaines cognitifs qui ne peuvent être mesurés par le MMSE.
>>> Test MoCA – mocacognition.com
Important : Il est nécessaire de suivre le programme de formation et de certification avant d’administrer, d’interpréter ou de noter les résultats du test. Source mocacognition.com
ANNUAIRE des essais et études cliniques
“L’annuaire des études et des essais cliniques est un registre national unique qui a pour but d’informer les patients, les professionnels de santé et le grand public sur les études cliniques médicamenteuses et non médicamenteuses menées en France par les différents promoteurs, qu’ils soient académiques ou industriels, dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.” – Source Fondation Vaincre Alzheimer
 https://essais-cliniques.vaincrealzheimer.org/
https://essais-cliniques.vaincrealzheimer.org/
 L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER ( ESA)
L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER ( ESA)
Les ESA sont rattachées à des SSIAD et destinées aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentée à un stade léger.
LA CONTENTION
 Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :
la contention et la liberté d’aller et venir…
Mise en Œuvre par la SFGG et avec le soutien de la CNSA – Source ARS Ile de France
” Le terme « contention » recouvre tous les moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de tout ou une partie du corps ou pour limiter la libre circulation des personnes dans un but sécuritaire pour une personne ayant un comportement jugé dangereux ou mal adapté.”
- Les différents types de contention
- Les répercussions de la contention
- Pourquoi la contention ?
- Les modalités de la mise en œuvre
- Dans le projet d’établissement …
- Dans le projet personnalisé …
- Les mesures alternatives
- En pratique, devant un risque de chute
- En pratique, devant une agitation
- En pratique, devant une déambulation excessive
- Le cas particulier des barrières de lit
 A propos de la contention physique des personnes âgées – ARS Ile de France
A propos de la contention physique des personnes âgées – ARS Ile de France
Information destinée aux patients résidents et à leur entourage
LE REFUS DE SOINS
 A lire DOSSIER très complet sur le refus de soins en gériatrie – Source maeker.fr.
A lire DOSSIER très complet sur le refus de soins en gériatrie – Source maeker.fr.
Situations cliniques, Contextes et aspects légaux, Épidémiologie et facteurs de risque,
Présentation clinique et modalités d’évaluation, Gestion du refus de soins, Impacts du refus de soins …
” Le refus de soins désigne la situation où une personne choisit de s’opposer à recevoir certains soins proposés par les professionnels de santé. Il peut être question de l’examen physique, de soins d’hygiène, de traitements médicaux, d’actes chirurgicaux, de la prise de paramètres vitaux, de prélèvements, d’aides à domicile ou en structure gériatrique, ou de tout autre type d’intervention. Il peut être temporaire, fluctuant ou permanent et se distingue de l’arrêt des soins qui est une décision médicale” – Source maeker.fr
![]() Aller plus loin...
Aller plus loin... La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
GUIDE d'aide à l'orientation des malades et des familles - Ile de France - Ars Ile de France
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
GUIDE d'aide à l'orientation des malades et des familles - Ile de France - Ars Ile de France
 La maladie d’Alzheimer - solidaritessante.gouv.fr
La maladie d’Alzheimer - solidaritessante.gouv.fr
 France Alzheimer et maladies apparentées - francealzheimer.org
Fondation Alzheimer - fondation-alzheimer.org
Fondation Vaincre Alzheimer - vaincrealzheimer.org
France Alzheimer et maladies apparentées - francealzheimer.org
Fondation Alzheimer - fondation-alzheimer.org
Fondation Vaincre Alzheimer - vaincrealzheimer.org![]() L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER ( ESA)
L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER ( ESA)